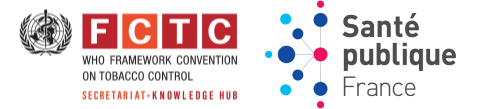L'étape suivant le diagnostic de la situation (voir page « Diagnostic de la situation ») est l'identification d'une intervention à implémenter. En effet, le diagnostic aura permis d’objectiver les besoins et de définir des objectifs de santé publique.
Le projet de conception d’une intervention implique de réaliser préalablement un état des lieux des dispositifs existants sur le sujet et des éléments qui ont fonctionné ou non. Cet état des lieux est généralement au moins partiellement réalisé lors du diagnostic de la situation. Il est préférable de privilégier des interventions déjà évaluées et efficaces. Une attention devra être portée à l’adaptation de ces interventions aux contextes culturels et locaux.
Interventions efficaces : qu'est-ce que cela signifie et quel intérêt ?
Une intervention est efficace lorsqu'elle produit des effets positifs sur les publics cibles au regard d’objectifs préalablement définis. Le fondement de la preuve de l’efficacité d’une intervention est l’établissement d’un lien de causalité entre l’action et les effets positifs constatés sur une problématique (ex. réduction du tabagisme, arrêt du tabac d’une partie de la population des fumeurs).
S’intéresser aux preuves de l’efficacité d’une intervention présente des intérêts sur tout le cycle de vie d’un projet : concevoir un projet à l’aune de ce qui fonctionne, prouver qu’un projet fonctionne, le pérenniser le cas échéant ou au contraire mettre fin à une action inutile ou néfaste.
Où trouver des informations portant sur l'efficacité d'interventions déjà implémentées ?
- Il est possible de réaliser une revue de littérature rapide des interventions déjà mises en place. Il existe des outils de recherche et bases de données pour faciliter la réalisation de revues de littérature : il s'agit souvent de ressources documentaires accessibles en ligne (par exemple, la Cochrane Library met à disposition des revues de littérature).
- Il existe différents registres recensant des interventions. Ces registres permettent d’aider les décideurs et acteurs locaux à choisir des interventions adaptées pour répondre à leurs besoins, à mettre en place une prévention scientifiquement fondée. En effet, les registres évaluent le niveau d’efficacité d’interventions et s’appuient sur une méthodologie précise et transparente. Pour en savoir plus sur les registres, voir la page « Registres d’interventions en prévention et promotion de la santé ». Sur le site internet du Knowledge Hub, il est aussi possible de trouver des catalogues d’interventions sur la sensibilisation au tabagisme : à la différence d’un registre, aucune méthodologie de classification des interventions selon leur efficacité n’a été établie par le Knowledge Hub : ces catalogues ont pour seule vocation de lister les interventions en lien avec la prévention du tabagisme qui sont répertoriées au sein des registres identifiés par le Hub.
Pourquoi privilégier des interventions déjà évaluées et efficaces ?
- Gain de temps de conception
- Gain de temps et économie de ressources pour une évaluation
- Gain d’expérience
- Utilité de la notoriété initiale, gain de confiance (publications scientifiques)
- Gain de profondeur temporelle (les interventions ont parfois bénéficié de suivis de plusieurs décades)
- Facilité : bénéficier de manuels existants, de formateurs et formations existantes, voire de dispositifs de contrôle qualité déjà conçus
- Permet de se concentrer sur l’adaptation aux contextes culturels et locaux et sur l’évaluation des adaptations, ce qui est déjà un travail potentiellement important
- Permet de se concentrer sur le monitoring de la qualité
Point d'attention : Rester alerte quant aux éventuels effets indésirables qui pourraient survenir dans le contexte local/visé.
Dans le cas de l'identification d'une intervention efficace, deux options sont possibles :
- L’intervention est validée dans un contexte comparable à celui qui a été identifié. La mise en œuvre, le suivi et son monitoring se font alors en lien avec le concepteur/développeur national ou régional du projet, dans la mesure du possible.
- L’intervention est validée scientifiquement mais dans un contexte différent. Tout le matériel de l’intervention, les indicateurs de suivi, la formation des intervenants doivent être traduits et/ou éventuellement adaptés au contexte, sans modifier les éléments qui lui confèrent son efficacité. L’évaluation doit être discutée avec les concepteurs du projet. Selon les cas, une nouvelle évaluation d’efficacité dans le nouveau contexte pourra être nécessaire.

Que faire si aucune intervention efficace n'a été identifiée ?
Il convient de rechercher des interventions nationales ou internationales prometteuses ayant fait l'objet d'une première évaluation (étude quasi-expérimentale ou au moins évaluation de processus). Ces interventions peuvent être recherchées en s’appuyant sur la littérature scientifique ou d'autres outils de recherche existants (tels que des registres spécifiques). Une fois qu’on aura trouvé une intervention qui correspond aux objectifs fixés, il faudra l'adapter et, idéalement, l'évaluer.
Dans le cas d’une intervention identifiée sans impact connu, il convient de se poser diverses questions :
- L’intervention a-t-elle déjà été décrite ? Présente-t-elle un mécanisme et une logique d’action convaincants ?
- Est-il possible de s’appuyer sur une expérience précédente et des outils existants (guide, documents de formation, plaquettes…) ?
- Une évaluation suggère-t-elle des résultats positifs, même s’ils n’ont pas été attestés ?
- Une autre intervention existe-t-elle pour répondre au besoin identifié avec un niveau de preuve supérieur ?
Si la réponse à ces questions est négative et si l’on souhaite malgré tout mettre en œuvre cette intervention, alors il est finalement possible d’envisager de construire un projet de recherche en prévention, en collaboration avec des équipes de recherche, pour mesurer l’impact de l’intervention. Ce choix implique un investissement économique important, ainsi que du temps et des ressources humaines.
Dans tous les cas, il est important de construire le choix de l’intervention avec les parties prenantes et particulièrement les bénéficiaires ou des représentants de la communauté concernée ; les différents acteurs doivent avoir la possibilité de s'approprier le projet et de garantir sa pertinence et l'adhésion de la cible de référence.